Apparition et développement de la médiation équine
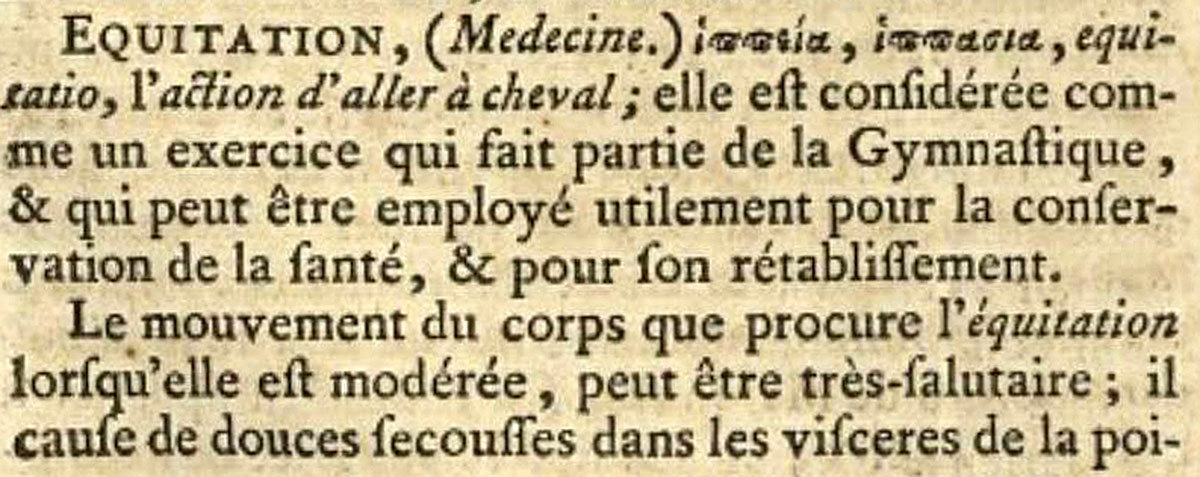
Une histoire pas si récente
Le cheval est lié à la santé et au salut des hommes depuis l’aube de l’humanité. Avant même d’être domestiqués, les chevaux apparaissent sous forme de peintures rupestres réalisées au cours de transes chamaniques qui vont accompagner les malades vers la guérison et guider les âmes des morts vers l’au-delà. Ces rituels religieux, dans lesquels des chevaux sont sacrifiés ou viennent assister les chamanes, font partie des motivations ayant poussé nos ancêtres à domestiquer les équidés.
La médecine de l’Antiquité grecque et romaine n’est pas en reste : Platon, Galien, Hippocrate ou encore Xénophon transmettront des traditions médicales dans lesquelles le contact avec le cheval et la pratique de l’équitation sont utilisées à des fins de prévention mais aussi de guérison de maladies mentales ou physiques, aussi bien que dans des intérêts éducatifs. Les effets de l’équitation sur la sensorialité, la rééducation motrice, les troubles du sommeil, l’épilepsie, la tonicité du corps, la capacité à réagir ou encore les troubles de l’humeur sont déjà connues par les soignants de l’Antiquité.
Un miracle médiatique ouvre la voie
Le mythe moderne fondateur des thérapies par la médiation équine repose toutefois sur l’histoire de Lis Hartel, cavalière Danoise ayant remporté une médaille d’argent en dressage aux Jeux Olympiques d’Helsinki en 1952 après avoir surmonté, à travers une rééducation intensive médiatisée par le cheval, une paralysie causée par une poliomyélite. Ce succès largement médiatisé lancera, depuis les pays scandinaves, le développement de l’hippothérapie – une approche kinésithérapeutique du mouvement du cheval.
Les pratiques se développent par ruptures
En France, Hubert Lallery sera le premier à publier sur le sujet dès 1962. Sa rencontre avec Renée de Lubersac donnera naissance en 1970 à l’ANDRE, devenue aujourd’hui la Fédération Handicheval.
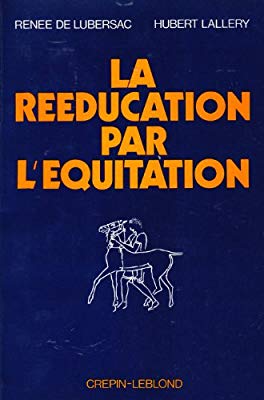
La suite du développement de la médiation équine en France se fera par des ruptures successives :
– rupture entre le milieu du soin avec le milieu du sport : qui façonnera la frontière entre les actuelles activités réglementées de sport et loisir équestre adaptés (équihandi) et les approches thérapeutiques avec le cheval ;
– rupture entre les approches de soin somatique et les approches de soin psychique : qui créera la frontière entre l’exercice de la médecine réglementée (hippothérapie) et les pratiques de soins hors cadre réglementé (équithérapie/TAC).
Plus récemment, le monde de l’accompagnement hors enseignement de l’équitation (équicie, horse coaching) prendra progressivement son indépendance à partir des années 2010.
La France est devenue un fer de lance
Ce cheminement par clivages rend l’actuel paysage français de la médiation équine assez complexe, car morcelé entre de nombreux organismes, réseaux et fédérations issus de courants divers et aux frontières relativement opaques et perméables. Pour autant, cette situation, si elle rend la lecture du paysage difficile pour le grand public, a favorisé la précision et la qualité des pratiques, car les divergences ont eu pour conséquence le développement d’approches mieux définies, qui se traduisent par l’existence de formations longues et de plus en plus spécialisées. En matière de médiation équine, la France jouit aujourd’hui, avec les Etats-Unis, du meilleur niveau de reconnaissance international.
L’enjeu actuel pour la filière est donc de gagner en clarté et unité : c’est la mission que s’est fixé le récent Syndicat Interprofessionnel des Praticiens de la Médiation Equine en regroupant les professionnels des différents courants (sport, loisir, accompagnement, thérapie, coaching), tout en défendant la spécificité et la qualité de leurs compétences respectives.
[texte : Nicolas Emond / SIPME]
[image : Encyclopédie de Diderot, tome 5, p.894 / capture d’écran Gallica]


